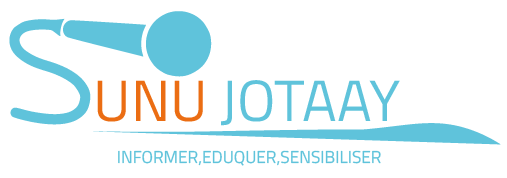Le 6 août 1945, les États-Unis larguent la première bombe atomique de l’histoire sur Hiroshima. Trois jours plus tard, Nagasaki subit le même sort. Ces deux attaques tuent plus de 210 000 personnes, dont près de 40 000 enfants, et en blessent 150 000 autres. Aujourd’hui, 80 ans après, les survivants les hibakusha peinent à faire vivre leur mémoire dans un Japon qui regarde ailleurs.
L’horreur des bombardements, vécue et racontée
À Nagasaki, Katsufumi Shiraishi, guide bénévole à la Fondation pour la paix, décrit une ville détruite par des températures de 4 000 °C et des vents soufflant à 245 km/h. Il raconte comment, assoiffés, des survivants ont bu de l’eau contaminée, et comment des milliers d’écoliers sont morts en une fraction de seconde.
Shigemitsu Tanaka, 4 ans en 1945, n’a rien oublié : les corps calcinés dans les rues, les charrettes remplies de cadavres, la puanteur dans l’air. « C’était terrifiant », résume-t-il.
Un souvenir qui s’efface lentement
Les survivants vieillissent : leur moyenne d’âge est de 85 ans. Et avec eux, la mémoire des bombardements s’estompe. Un sondage révèle que 80 % des Japonais ignorent les dates exactes des attaques. À Hiroshima, certains élèves associent leur ville à l’équipe de baseball locale, les Carpes, plutôt qu’au drame nucléaire.
Dans les écoles, des enseignants refusent même l’intervention des hibakusha, surtout lorsqu’ils évoquent la catastrophe de Fukushima ou critiquent la relance des centrales. Leurs récits, répétés mille fois, semblent lasser.
Pour contrer cette disparition de la mémoire, des survivants forment des « successeurs » chargés de transmettre leur histoire. Après trois ans de formation, ces témoins apprennent à relater les faits, mais aussi la douleur, la peur, et l’humanité de ceux qui ont vécu l’indicible.
Le pacifisme remis en question
Face aux tensions mondiales et à la guerre en Ukraine, le Japon revoit sa politique de défense. Le gouvernement envisage de doubler ses capacités militaires et de modifier l’article 9 de la Constitution, qui interdit tout recours à la guerre.
À Hiroshima, cette volonté passe mal. Chaque été, lors des commémorations, le maire de la ville critique publiquement Tokyo pour son éloignement du pacifisme. Il reproche aussi au gouvernement de ne pas signer le traité de l’ONU sur l’interdiction des armes nucléaires, adopté en 2017 grâce au combat des hibakusha. Le Japon, protégé par le parapluie nucléaire américain, refuse toujours de s’y engager.
L’art, exutoire d’une mémoire collective
La bombe atomique a profondément influencé la culture japonaise. En 1954, Godzilla, monstre réveillé par des essais nucléaires, apparaît au cinéma et symbolise la peur de l’atome. Des spectateurs quittent la salle en larmes.
Dans les années 1960, le théâtre butô, avec ses corps couverts de cendres, exprime le traumatisme à travers une gestuelle inédite. La douleur devient art. Les mangas et animés, comme Evangelion, reprennent ces thèmes. Pluie noire, roman de Masuji Ibuse publié en 1965, aborde les discriminations subies par les irradiés. Une « littérature de la bombe » émerge, mêlant témoignage, mémoire et résilience.
Transmettre pour ne pas oublier
Alors que les hibakusha disparaissent peu à peu, leur combat continue à travers leurs héritiers. L’art, la littérature et l’éducation restent les derniers remparts contre l’oubli. À Hiroshima et Nagasaki, on le sait : se souvenir, c’est résister.