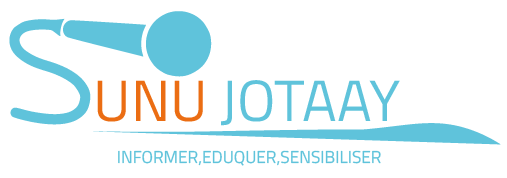L’auteur franco-camerounais Charles Onana est jugé à Paris pour complicité de contestation du génocide des Tutsi au Rwanda en 1994. Accusé d’avoir minimisé et contesté la nature même de ce crime contre l’humanité, son procès, qui s’ouvre ce lundi, pourrait faire jurisprudence en France.
Un procès inédit pour contestation de génocide
Le tribunal correctionnel de Paris accueille à partir de ce lundi le procès de Charles Onana, un auteur controversé, accusé de complicité de contestation du génocide des Tutsi au Rwanda en 1994. Ce procès est seulement le second de ce genre en France, après celui de la journaliste Natacha Polony en 2022. Onana est jugé en lien avec son ouvrage « Rwanda, la vérité sur l’opération Turquoise. Quand les archives parlent », publié en 2019, dans lequel il remet en cause la nature planifiée du génocide et propose une vision conspirationniste des événements.
Le génocide des Tutsi, orchestré par le régime extrémiste hutu entre avril et juillet 1994, a causé la mort d’environ 800 000 personnes, principalement des Tutsi et des Hutu modérés. Pourtant, dans son livre, Onana évoque ce qu’il qualifie de « double génocide », affirmant que des représailles orchestrées par le Front Patriotique Rwandais (FPR) ont visé les Hutu après les massacres, une thèse qui fait l’objet de débats vifs.
Des accusations de négationnisme
La plainte contre Charles Onana, déposée par des associations de défense des droits de l’homme, dont Survie et la Ligue des droits de l’Homme (LDH), repose sur des passages de son livre où l’auteur met systématiquement le terme « génocide » entre guillemets et affirme que « le conflit et les massacres du Rwanda n’ont rien à voir avec le génocide des Juifs ». Ces propos ont été jugés suffisamment graves pour que l’auteur soit mis en examen en 2022 pour « contestation publique de crime contre l’humanité ».
L’éditeur du livre, Damien Serieyx, est également poursuivi pour ces mêmes faits, le droit de la presse tenant les éditeurs pour responsables de la publication des ouvrages qu’ils diffusent. Selon les plaignants, ces propos minimisent la réalité des événements de 1994 et constituent une violation de la loi française de 2017 qui punit la négation des génocides reconnus par la France.
Une défense qui plaide la recherche historique
Charles Onana, qui se présente comme politologue et journaliste d’investigation, réfute catégoriquement les accusations de négationnisme. Son avocat, Me Emmanuel Pire, assure que son client ne remet pas en question l’existence du génocide des Tutsi, mais qu’il propose une analyse fondée sur dix ans de recherche. « Il s’agit d’un travail universitaire visant à comprendre les mécanismes du génocide, avant, pendant et après », affirme-t-il.
La défense a également cité une vingtaine de témoins, dont d’anciens officiers militaires français et rwandais, pour appuyer ses arguments. De leur côté, les parties civiles feront appel à des experts, historiens et professeurs de droit, pour démontrer la gravité des propos tenus par Onana et l’impact qu’ils pourraient avoir sur la mémoire des victimes du génocide.
Un précédent juridique attendu
Ce procès est perçu comme un moment clé pour la justice française. « Il n’existe pas encore de jurisprudence claire en lien avec la contestation du génocide des Tutsi », a déclaré Camille Lesaffre, chargée de campagne de l’association Survie. Le verdict pourrait donc marquer un tournant, en définissant les limites de la liberté d’expression lorsqu’il s’agit de crimes contre l’humanité.
Le premier procès de ce genre, en 2022, avait vu la journaliste Natacha Polony relaxée par les juges, estimant que ses propos controversés n’étaient pas une négation du génocide. Toutefois, ce second procès se concentrera sur des écrits beaucoup plus explicites et directement liés à une contestation de la planification du génocide.
Conclusion : Un enjeu mémoriel et juridique
Au-delà des seules implications légales, ce procès pose la question de la responsabilité des intellectuels et des auteurs face à l’histoire. Pour de nombreux observateurs, il s’agit d’un test crucial pour savoir comment la justice française traitera à l’avenir les tentatives de minimisation ou de négation de crimes aussi tragiques que le génocide des Tutsi au Rwanda. Les audiences, qui devraient durer plusieurs jours, seront suivies de près, tant en France qu’à l’international, notamment par les défenseurs des droits de l’homme et les rescapés du génocide.