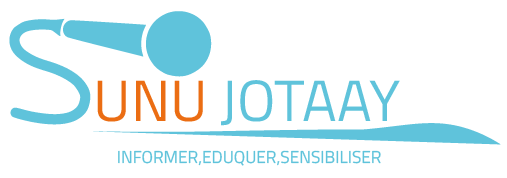Présentés comme une « dette cachée » héritée de l’ancien régime, les 7 milliards de dollars révélés récemment ont provoqué une onde de choc politique et économique. Pourtant, cette somme n’est ni une découverte ni un détournement. Elle résulte d’un reclassement comptable du FMI intégrant les dettes des entreprises publiques dans la dette nationale. Une réalité technique mal expliquée qui a mis à l’épreuve la confiance des investisseurs et la crédibilité de l’État.
L’annonce a été perçue comme une bombe : une dette de 7 milliards de dollars jusque-là « dissimulée » aurait été révélée dans les comptes publics. Cette information a immédiatement relancé les accusations contre l’ancien pouvoir, nourrissant le débat sur la transparence financière. Mais la vérité est plus nuancée. Il ne s’agit pas d’un détournement ni d’une découverte tardive, mais d’un reclassement comptable décidé par le Fonds monétaire international (FMI), dans le cadre des nouvelles normes de transparence financière.
Concrètement, cette somme correspond à la consolidation des dettes et engagements de plusieurs entreprises publiques : Senelec, Petrosen, Air Sénégal, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), le Port autonome de Dakar, entre autres. Ces structures, bien qu’étatiques, gèrent leurs propres budgets. Le FMI a simplement considéré que leurs dettes peuvent, en cas de difficulté, retomber sur l’État et doivent donc être comptabilisées dans la dette publique.
Sur les 7 milliards de dollars, environ 3 milliards sont des dettes effectives contractées pour financer des projets d’infrastructures, d’énergie, de transport ou d’habitat. Les 4 milliards restants sont des « passifs contingents », c’est-à-dire des engagements potentiels que l’État ne paiera que si ces entreprises ne parviennent plus à honorer leurs obligations. À ce jour, aucune de ces structures n’est en faillite, mais beaucoup fonctionnent grâce au soutien régulier du Trésor.
Là où le problème s’est amplifié, c’est sur le plan politique et communicationnel. Au lieu d’expliquer calmement le caractère technique de cette reclassification, certains responsables ont évoqué une « dette cachée » ou un « trou budgétaire ». Résultat : les marchés financiers se sont affolés, le FMI a suspendu temporairement son programme, les taux d’emprunt du Sénégal ont augmenté, et plusieurs projets publics ont été ralentis.
Cette situation a également entraîné un abaissement de la note souveraine du Sénégal par les trois grandes agences de notation internationales : Moody’s, Fitch Ratings et Standard & Poor’s. Une triple alerte qui traduit une perte de confiance et un risque financier accru pour le pays.
Paradoxalement, si l’on voulait renforcer la transparence, les véritables zones d’ombre demeurent : dépenses de souveraineté, marchés de gré à gré, fonds spéciaux. Le débat s’est focalisé sur les dettes publiques, mais a laissé de côté la question de la gouvernance quotidienne.
Ce qui n’était qu’une question de normes comptables est donc devenu une crise politique, économique et de confiance. La principale leçon à retenir : dans un contexte de tension économique et de suspicion généralisée, la pédagogie économique n’est plus un luxe, mais une nécessité absolue.