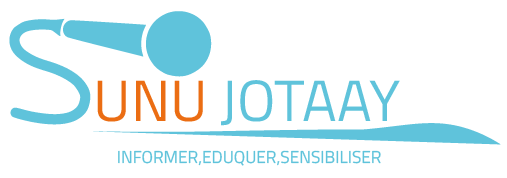Entre surpêche, licences opaques et pêche illégale, les ressources maritimes d’Afrique de l’Ouest s’épuisent. Une situation aggravée par une gouvernance défaillante, mettant en péril un secteur vital pour des millions de personnes.
L’Afrique de l’Ouest, avec ses eaux poissonneuses et sa biodiversité marine exceptionnelle, devrait être un eldorado pour les pêcheurs et un moteur économique pour la région. Pourtant, la réalité est bien différente. De la Mauritanie au Sénégal, en passant par la Guinée-Bissau et la Sierra Leone, la gestion halieutique est minée par des pratiques de gouvernance contestables, souvent dictées par des intérêts privés ou étrangers au détriment des populations locales.
Les accords de pêche conclus entre certains États et de grandes flottes industrielles étrangères sont souvent négociés dans l’opacité. Des licences sont accordées sans réelle transparence, permettant à des navires-usines de capturer des tonnes de poissons, parfois bien au-delà des quotas fixés. Résultat : les stocks halieutiques déclinent, et les pêcheurs artisanaux se retrouvent en concurrence directe avec des mastodontes équipés de technologies de pointe.
À cela s’ajoute la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), un fléau qui coûte chaque année des centaines de millions de dollars aux économies ouest-africaines. Dans certaines zones, les autorités maritimes manquent cruellement de moyens pour surveiller et contrôler les activités en mer.
Les conséquences sont lourdes : insécurité alimentaire, perte d’emplois dans la pêche artisanale, conflits entre pêcheurs et industriels, mais aussi dégradation des écosystèmes marins. Les experts alertent sur le fait que, sans réforme urgente, certaines espèces pourraient disparaître des eaux ouest-africaines dans les prochaines décennies.
Des voix s’élèvent pour réclamer une gouvernance plus rigoureuse : transparence totale des licences, renforcement des moyens de surveillance maritime, lutte coordonnée contre la pêche INN et implication réelle des communautés locales dans la gestion des ressources. Car au-delà d’un enjeu économique, c’est la souveraineté alimentaire et environnementale de toute la région qui se joue dans ces eaux.